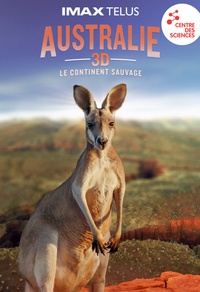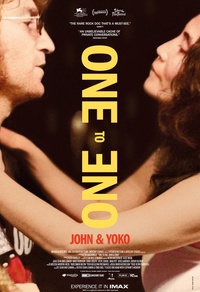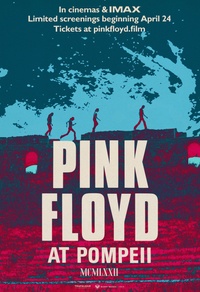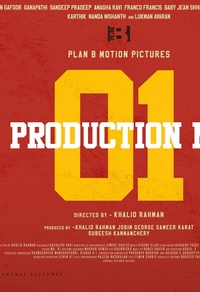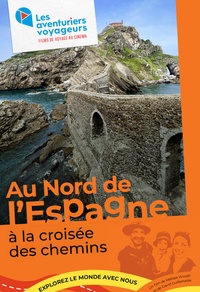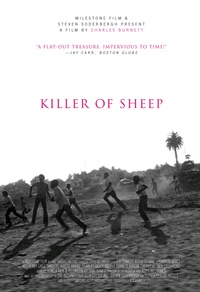Certains pestent contre l'investissement du gouvernement dans notre cinématographie (qui est, la plupart du temps, déficitaire), tandis que d'autres se plaignent des procédures complexes et fastidieuses qui entourent les demandes de subventions liées à la production de longs métrages au Québec, et quelques-uns, comme moi, apprécient l'aide gouvernementale qui nous permet d'avoir une cinématographie riche et variée, sans pour autant endosser chacune de leurs exigences.
Même si je cautionne l'appui gouvernemental, je ne suis pas moins fière et rassurée (en tant que Québécoise et critique) qu'il existe des moyens - et des gens passionnés - pour parvenir à faire du cinéma sans l'argent des institutions. Et s'il faut voir le logo de Super Écran dans une pluralité de plans (comme ce fut le cas dans À vos marques... Party!) alors soit! Qui ça dérange, vraiment?
Après avoir visionné le long métrage Y'en aura pas de facile, de Marc-André Lavoie, la semaine dernière, j'ai été stupéfaite de savoir qu'il était parvenu à produire un film de cette envergure pour 350 000 $. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que la plupart des gens ignoraient ce que ce nombre signifiait (c'est beaucoup ou pas?). Voici donc certains détails relatifs aux subventions ainsi que sur les compromis qu'un artiste doit faire pour parvenir à ses fins sans l'argent de la SODEC et de Téléfilm Canada.
Le nombre de chanceux qui reçoivent l'aide gouvernementale chaque année est assez restreint. Et ceux qui font partie des quelques élus, souvent en raison de leur acharnement, doivent parfois faire face à des problèmes incontrôlables tels que des diminutions budgétaires importantes. Ce fut d'ailleurs le cas du film Piché : Entre ciel et terre, qui a dû travailler avec deux millions de moins que le devis initial le prévoyait. « On avait au départ un scénario qui était budgété à 9 millions $, et puis il s'est avéré que nous n'aurions pas plus que 7 millions $. Couper 2 millions $ sur un film, c'est énorme. Tu ne peux pas juste dire : on va enlever la chaise ici ou le char là, alors il fallait refaire le film », a précisé le scénariste Ian Lauzon lors de la tournée de promotion du film sur le pilote québécois, qui a amassé, jusqu'à maintenant, plus de 3 millions $ au box-office.
C'est donc pourquoi de nombreux créateurs, tel que Marc-André Lavoie - qui a lancé son deuxième long métrage, Y'en aura pas de facile, hier - décident de produire leur film par leurs propres moyens, sans l'appui des institutions. Pour y parvenir, le réalisateur et producteur a, entre autres, réduit considérablement ses effectifs sur le plateau. « Nous étions sept personnes en moyenne sur le plateau alors qu'en général plus de 25 personnes s'affairent derrière la caméra », explique Marc-André Lavoie en entrevue avec Cinoche.com. Les comédiens, tous très connus dans le milieu, ont été payés au salaire minimum permis par l'Union des artistes. « J'apprécie grandement la générosité de chacun des acteurs qui ont travaillé sur le projet. Ils ont tous cru en mon idée et ont bien voulu m'aider à la rendre vivante », se réjouit le réalisateur québécois.
Super Écran et Les Films Séville ont investi à priori dans le film et les compagnies Loto-Québec et Réseau contact (qui exposent leurs produits respectifs dans le film) ont toutes deux versé un cachet à la production comme commanditaire. « Nous les avons appelés simplement pour savoir si nous pouvions utiliser leur nom et c'est eux qui nous ont proposé d'être commanditaires ». Le seul financement que Marc-André Lavoie a réclamé aux institutions en est un accordé à la post-production. « La SODEC a refusé, mais Téléfilm Canada nous a donné 150 000 $ », déclare celui qui a fait son premier film, Bluff, également sans demander de l'aide financière au gouvernement.
Marc-André Lavoie n'a par contre aucune rancune ou animosité envers la SODEC ou Téléfilm Canada. Il considère uniquement qu'un film comme le sien, qui nécessitait un budget de moins d'un million $ et à saveur plus populaire, aurait eu de la difficulté à recevoir du financement. « Dans le programme régulier, si les institutions ont le choix entre un film d'auteur à un million ou un film populaire à un million, ils auront tendance à privilégier le film d'auteur simplement parce que les films populaires coûtent en général plus cher. Et je n'allais pas gonfler mon budget inutilement juste pour avoir une chance de me faire financer. »
Même lorsque des projets reçoivent l'appui des deux organismes gouvernementaux, comme dans toutes les autres industries culturelles, des problèmes peuvent survenir. Jeremy Peter Allen, réalisateur du film Manners of Dying, a subi une grande déception lorsque son projet de film - titré Mafia Boy -, (finalement) approuvé par la SODEC et Téléfilm, a été arrêté pour perte des droits. « Lorsque les deux institutions ont embarqué dans le projet, nous n'avions plus les droits sur l'histoire depuis deux semaines. Le projet a donc été complètement abandonné. C'est déprimant mais c'est un milieu où il nous arrive souvent d'essuyer un échec. Il ne faut pas se décourager. »
Pour pouvoir faire un film avec un budget respectable, la plupart des créateurs qui choisissent de se faire financer par le gouvernement doivent recevoir l'appui des deux institutions en même temps. « Lorsque l'une des deux accepte et que l'autre refuse, la seconde a tendance à prioriser le film qui a été choisi par la première lors du concours suivant. Les deux instances travaillent ensemble pour tenter de développer le plus de films possible et encourager la création », précise M. Peter Allen, également chargé de cours au Certificat en études cinématographiques à l'Université Laval.
Les deux instances ont sensiblement les mêmes buts et objectifs, par contre « dans l'industrie, c'est un peu un genre de convention de dire que Téléfilm Canada investit davantage dans le cinéma populaire alors que la SODEC préfère les films d'auteur », indique Jeremy Peter Allen. « Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose puisque ça renforce la diversité. »
Même si je considère que notre cinématographie serait perdue, ou très mal en point, sans l'appui financier des institutions, je ne peux que me réjouir de voir que tous les artisans de l'industrie - comédiens, réalisateurs, producteurs - travaillent ensemble pour maintenir notre cinématographie vivante. Le fait que des comédiens connus du public et du milieu, tels que Claude Legault ou Rémy Girard qui, avouons-le ne sont plus payés au salaire minimum depuis bien longtemps, acceptent de recevoir un salaire dérisoire et de consacrer quelques jours de leur agenda chargé pour un film qui leur tient à coeur, est encourageant. Cela démontre que l'industrie du cinéma n'est pas une usine à cash, c'est l'image de notre culture, l'exposition du talent que renferme notre province. Je lève mon verre (ou mon clavier plutôt) au cinéma et à son avenir et son succès!
Pour mieux saisir le rôle et l'implication des deux institutions dans le financement cinématographique, voici quelques détails attachés à chacune d'elles :
SODEC
Argent alloué par année : 24 millions $, représentant entre 16 et 19 films, dont les trois quarts sont en françaisCoût pour une demande : 1000 $Période de l'année pour présenter une demande : janvier et septembre.Dépositaire de la demande : maison de production
Téléfilm Canada
Argent alloué par année : 12 millions $ + les enveloppes fondées sur la performance* (qui constituent elles aussi environ 12 millions $), représentant environ 14 films en français par anCoût pour une demande : gratuitPériode de l'année pour présenter une demande : février, septembreDépositaire de la demande : maison de production
*Enveloppes fondées sur la performance :Les producteurs ayant obtenu les meilleurs box-offices l'année précédente reçoivent des enveloppes à la performance qui leur permettent de développer et produire les films de leur choix, sans avoir à les faire évaluer par Téléfilm Canada au concours comparatif du programme d'aide sélective.