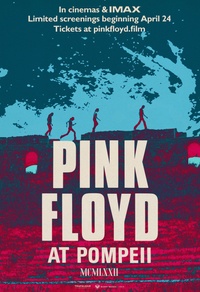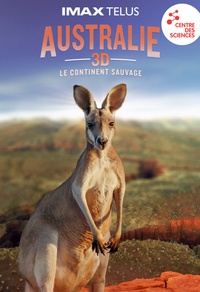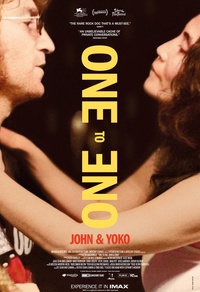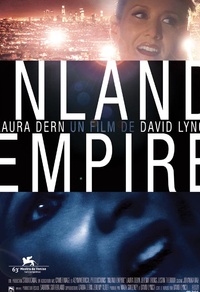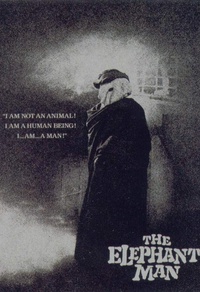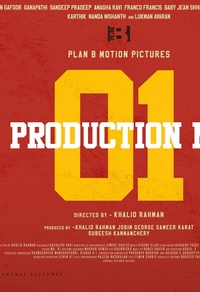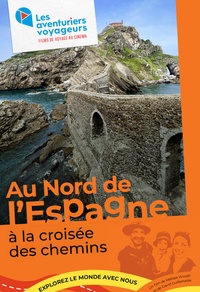Une réplique du film Braveheart résume bien la ligne narrative derrière chaque film dont l'histoire met en scène le cancer. « Every man dies, not every man really lives », affirme William Wallace à sa dulcinée. Ce vendredi, un nouveau film s'ajoute à la liste. Le brillant 50/50, une comédie dramatique sur les enjeux auxquels doit faire face un jeune patient cancéreux qui voit ses chances de survie réduites à 50%, nous rappelle que derrière tout ce qui meuble nos vies, la seule véritable chose d'importance, ce sont les liens que l'on entretient avec nos semblables.
Car lorsque le diagnostic frappe, un choix s'impose naturellement au patient : doit-il poursuivre son chemin comme si de rien n'était ou bien doit-il voir la maladie comme un signe que son mode de vie doit être modifié? La quête du bonheur que tous mènent, une fois limitée par un ultimatum médical, doit être l'objectif principal du temps qui reste... Cela vous rappelle un film? Cela devrait vous en rappeler plus d'un.
Dans le genre, on peut citer A Walk to Remember, une histoire sirupeuse qui, malgré son titre, n'aura finalement laissé que peu de souvenirs à son public. Peut-être plus marquant, Sweet November est un film plein de défauts et d'une incroyable superficialité, dont la thématique demeure toutefois valide. Ses personnages invraisemblables et dessinés au marqueur sur papier buvard n'enlèvent rien au message : dans une vie qui s'achève, tout ce qui relève du monde physique apparaît comme vide de sens. Or, le personnage de Charlize Theron tente de donner du bonheur aux autres, mais n'accepte personne dans sa bulle et elle échoue donc à entrer en relation, ne voulant dépendre de personne. Ce repli sur soi du personnage principal, d'une déprimante lourdeur, tue peut-être le film en ne laissant filtrer qu'un désespoir inutile. Le désir absurde du personnage de laisser un « beau souvenir d'elle-même », figé, est aussi superficiel que le film lui-même. Quoi qu'il en soit, bien des femmes auront versé des larmes sur Only Time de Enya en disant « Quelle belle histoire! ». Belle histoire certes, mais si Charlize Theron avait été laide, il n'y aurait pas eu d'histoire du tout.
Au contraire, dans le touchant Life as a House, Kevin Kline joue le rôle d'un architecte raté qui voit sa médiocre vie chamboulée le jour où il apprend qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il s'efforcera alors de renouer des liens avec son fils en le forçant à construire une maison avec lui pendant un été, afin de pouvoir lui léguer quelque chose de concret. Le film, étonnamment symbolique pour une histoire aussi simple, réussissait à créer chez le spectateur une identification complète. Le cancer ici n'était qu'un prétexte pour nous rappeler l'importance de vivre, et de le faire pour des raisons valables : le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin, et le bonheur se déroule au présent. Dans la vie comme dans Life as a House, pour construire un bonheur à soi, il faut parfois être prêt à détruire ce qui nous retient dans le passé. L'image de la vieille maison qui s'écroule pour laisser sa place à de nouvelles fondations est très forte et illustre en contrepoint l'état du malade : plus la charpente saine de la nouvelle maison s'érige, plus son corps se désagrège. L'enveloppe corporelle est détruite à la mort, soit, mais l'âme elle, en est purifiée.
Que dire de Big Fish, le plus lumineux de tous les Tim Burton? Là aussi, une relation père-fils compliquée par un manque de communication et une incompréhension mutuelle, encore une urgence de remettre les choses en ordre avant de partir. C'est par une histoire dans une histoire que Burton livre son message. Par une fiction dans une fiction, les liens entre les personnages se renforcent. Trois conteurs, trois niveaux d'auditeurs. Le réalisateur nous raconte le film, le fils raconte à son père l'histoire qu'il a entendue de lui des milliers de fois et la fait sienne. Par cette transmission du patrimoine oral, le père lègue à son fils ce que Burton lègue à son public : une formidable ode à la vie et à la famille.
Plus récemment, Alejandro González Iñárritu a également abordé cette thématique de la rédemption par l'amour à la veille de la mort, dans son dernier film, Biutiful. Ici, la dureté du quotidien du personnage central s'oppose à des moments de pure grâce où l'espoir se confond bien souvent avec le désespoir. L'interprétation de Javier Bardem, toute en nuances, permet à l'histoire d'exister. Pour soustraire ses enfants à la misère et leur léguer un avenir, il est prêt à tout leur sacrifier. Les valeurs familiales y sont souveraines et le reste est un flou moral où seule la survie compte. C'est un film au rythme lent et à la symbolique omniprésente, mais c'est avant tout un film dur qui ébranle son spectateur.
Car le cancer qui gangrène nos sociétés, l'égocentrisme, peut être contrecarré par des actions et des valeurs altruistes qui donnent un sens à l'existence. Par la maladie survient souvent, comme une épiphanie, l'urgence de léguer à un proche, de laisser une empreinte de soi avant de disparaître. Ce sont les derniers soubresauts de vie, le désir exalté de marquer le monde pour ne pas être oublié.
L'amour rédempteur est un concept vieux comme le monde et la rédemption est impossible lorsqu'on est seul. Au bout du compte, pour que l'amour (et la rédemption) existe, il faut être au moins deux. À l'instar des personnages de ces films, les véritables créateurs désirent également laisser une trace d'eux-mêmes dans nos vies, en apportant leur contribution au patrimoine cinématographique et ainsi, d'une certaine façon, atteindre l'immortalité. Or, pour qu'un film sur cette thématique atteigne son objectif, il doit impérativement entrer en relation avec son spectateur et passer, non par une froide analyse rationnelle, mais en touchant droit au coeur.