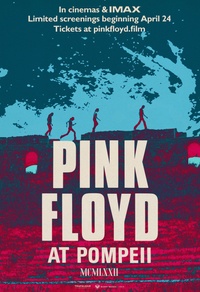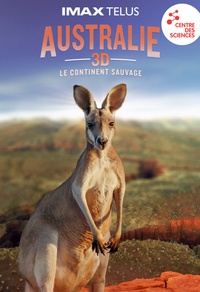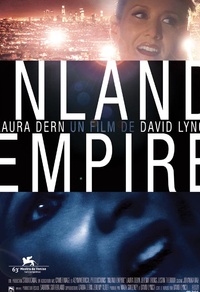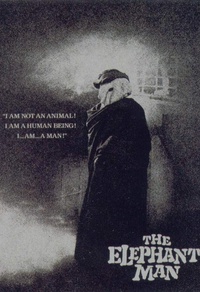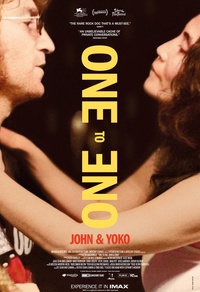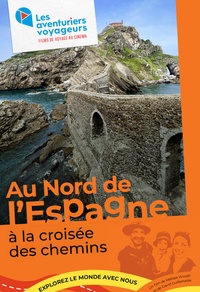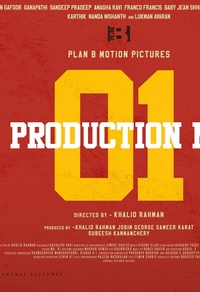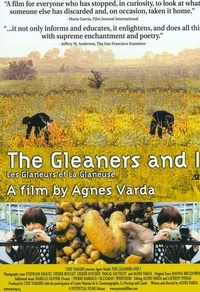Ivan Grbovic, le réalisateur des courts métrages La tête haute, Les mots et La chute, présente cette semaine son premier long métrage, Roméo onze. Coécrit avec Sara Mishara, qui est également directrice photo, le film raconte l'histoire de Rami, un Libanais handicapé qui entretient une relation sur internet avec une jeune fille. Réunissant tout son courage, il décide un jour de l'inviter au restaurant. Ali Ammar incarne le protagoniste.
Les deux scénaristes, qui forment aussi un couple, ont développé ce projet de très près. « On fait un film assez visuel, c'est extrêmement important pour un réalisateur et son directeur/directrice photo de bien s'épauler, de connaître l'histoire ensemble, d'avoir la même vision. Écrire le film ensemble ça a permis d'avoir le même film en tête. »
« Sara a cette capacité d'être honnête avec ce que le film est. Elle n'essaie pas de rendre les images trop hollywoodiennes, ou même trop ternes, elle regarde vraiment la matière, elle lit le scénario et elle donne une image qui correspond au cinéaste. »
Cette dernière confirme l'avantage d'être aussi co-auteur. « Dans un monde idéal, sur le plateau, il y a une symbiose qui s'est faite et les deux ont la même idée en tête. Nous, il y avait une étape de plus parce qu'on pouvait discuter de l'approche de l'histoire du scénario sur le plateau. On pouvait changer d'idée, on pouvait trouver d'autres façons d'exprimer ce qu'on avait écrit. Ça emmenait le métier de directeur photo à une autre étape, mais c'est quand même notre job de conter en images, donc je pense que ça amène plus à un rapprochement avec un réalisateur. »
« Ce qui est important pour un premier film, c'est de puiser dans cette naïveté, dans ce premier regard. Le danger, c'est quand un DOP d'expérience veut montrer quelque chose de pro. C'est une notion désuète, qui ne s'applique plus. »
« J'aime Sara parce qu'on partage les mêmes ambitions esthétiques et scénaristiques, poursuit Ivan Grbovic. Elle a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup aidé, mais je la connais très bien et il n'y a rien de nouveau par rapport à son professionnalisme et la façon qu'elle épaule son réalisateur. Elle a fait tous mes courts métrages... Faire un film, surtout faire un premier film, c'est comme faire en sorte que le réalisateur s'épanouisse, qu'il ressente qu'il n'y a pas de mécanismes autour de lui. C'est vrai pour tous les films, mais pour un premier en particulier : souvent, un réalisateur ne veut pas exprimer quelque chose de parfait, parfois c'est quelque chose de naïf. »
Elle poursuit : « Oui, et aussi, dans notre cas, le fait qu'on tourne avec un non-acteur, le fait de ne pas ressentir la technique au niveau de la réalisation devient important. C'est toujours le désire, pour moi, de ne pas entourer les comédiens de lumières et de marques à un tel point où ils n'ont plus de place pour jouer, mais c'est encore plus important ici parce que notre personnage fallait lui donner le plus d'espaces possible. »
Ali Ammar est un acteur non professionnel et sans expérience. « Ali a beaucoup travaillé son rôle. Il a eu un peu de coaching, il est allé chercher un peu dans ses expériences pour comprendre le scénario. Il était prêt. Il ressemble au personnage, il a un côté un peu cocky... » Vous a-t-il appris des choses sur le personnage que vous ne soupçonniez pas? « Il a approfondi le personnage; je ne suis pas Libanais, je ne suis pas handicapé, dans ce sens-là c'est un peu un squelette qui lui a rempli. C'est inspirant. Moi, un jeune garçon comme lui, qui ne sait pas jouer, qui a une histoire à raconter... Il avait quelque chose en tête. Il voulait faire ce film parce qu'il se sent comme le représentant d'une certaine population, et je trouve ça courageux de sa part. »
Comment réagiriez-vous qu'on reprenne votre film en une thèse politique et sociale? « Je ne sais pas... C'est clair que ce n'est pas politique, comme film, dans ce sens-là je suis très naïf. Je ne sais pas... C'est tellement un point de vue singulier que je préfère que chacun cherche ou comprenne ce qu'il veut comprendre. Ultimement, le message n'est pas méchant, ce n'est pas un message coup-de-poing à la Laurentie; la fin reste généreuse, donc je n'ai pas peur de ce que les gens peuvent comprendre. »
C'est pourtant parfois ce qui se produit; le personnage devient le représentant de toute une classe d'immigrants... « Ce n'était pas supposé être mon premier film, c'était supposé être un court métrage, c'est devenu un long parce que j'ai trouvé que la matière était là. Je le redis, c'est comme mon slogan : je voulais faire un film avec des immigrants qui ne parlent pas d'immigration, de racisme ou de guerre. On est rendu dans un point dans l'histoire du Québec où on ne peut pas cacher les immigrants, qui veulent s'épanouir de la même façon que les Québécois de souche. Ce n'est plus politique... ils sont juste Montréalais. Ali Ammar, il aime les Canadiens, il adore Carey Price, il parle avec un gros joual... c'est un Montréalais. Juste un Montréalais. »
Poursuivrez-vous dans cette voie? « Les inégalités, les différences, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On est parents, tsé. On veut faire des films qui posent des questions, qui ne sont pas nihilistes. Je n'ai plus vingt ans, je n'ai pas le goût de faire des films destroy, qui mettent à terre. Je veux discuter avec mon spectateur davantage. »
Roméo onze prend l'affiche ce vendredi à Montréal et à Québec.