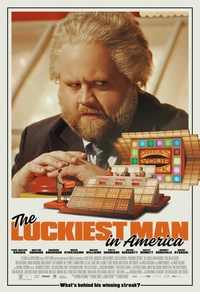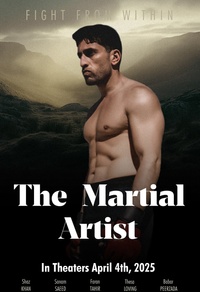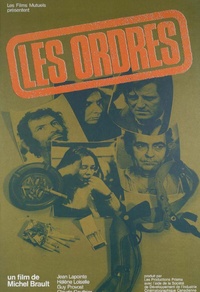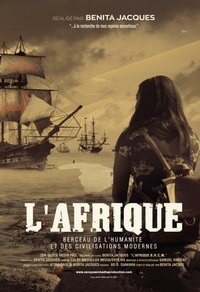Depuis un quart de siècle, Bertrand Bonello explore l'âme humaine à travers des oeuvres fascinantes et déstabilisantes. Après des débuts obscurs et dérangeants (notamment avec Le pornographe et Tiresia), il a su offrir des fresques d'époque qui sortaient largement des sentiers battus (Saint Laurent, L'Apollonide), se voulant un des chefs de file du cinéma indépendant avec son lot de productions radicales (Nocturama, Zombi Child, Coma).
Son dixième long métrage, La bête, se déroule dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle. Comme les émotions humaines sont proscrites, une femme (Léa Seydoux) doit replonger dans ses vies antérieures afin de purifier son ADN. Non seulement elle y retrouve son grand amour (George MacKay), mais elle doit également faire face à une menace aux conséquences funestes...
Cinoche a rencontré le cinéaste dans le cadre des Rendez-vous d'Unifrance, à Paris.
J'ai l'impression que vous faites vivre aux spectateurs la même sensation qu'à votre personnage.
Oui. Je voulais que le spectateur soit à la hauteur du personnage : jamais en avance ou en retard. Si le spectateur est perdu, c'est parce que le personnage l'est également.
Qu'est-ce qui vous intéressait dans la nouvelle La bête dans la jungle d'Henry James? Il y a quelque chose de déconcertant dans cette oeuvre qui m'a autant fait penser à David Lynch qu'au diptyque In the Mood for Love/2046de Wong Kar-wai, au Three Times de Hou Hsiao-hsien ou encore L'année dernière à Marienbad d'Alain Resnais.
Les références sont lourdes! (rires) L'écriture a été un long chemin. Toutes les idées ne sont pas venues d'un coup. Je voulais mélanger les genres, et qu'il y ait du mélodrame. Ce qui m'a amené vers cette nouvelle, c'est cette relation très forte entre l'amour et la peur. Je trouve que ce sont deux sentiments qui vont bien ensemble.
Le thème de se défaire de ses émotions pour pouvoir correspondre au modèle d'une société coercitive ne semble plus appartenir à la science-fiction.
En effet. Je crois que nos affects sont malmenés et que la société exerce de plus en plus de contrôle. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Le film propose un monde sans peur qui ne me fait pas rêver. Il y a la peur qui paralyse, qui est une peur atroce : c'est celle qu'on nous inflige à longueur de journée. Mais il y a également une peur que je trouve passionnante : celle qui nous rend vivant et qui nous rend aux aguets. En étant aux aguets, on est perceptible au monde.
Le film est très psychanalytique. Il joue avec nos émotions et nos angoisses, s'attardant à l'intelligence artificielle, qui est un sujet criant d'actualité.
Il ne faut pas sous-estimer la part inconsciente de la création. Je ne suis pas arrivé en me disant que j'allais parler de ça et de ça. Il faut parfois que le film soit fini pour qu'on s'aperçoive de ce dont il parle. Mais je pense que c'est évidemment ma propre peur d'une société de contrôle, ma propre peur de comment la technologie, qui devrait être un outil qu'on maîtrise, est en train de devenir un outil qui nous maîtrise. Ce sont des peurs réelles, qui sont très contemporaines.
Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur Léa Seydoux?
C'était une évidence. Je pense que c'est la seule actrice française qui pouvait correspondre aux différentes époques. Elle est à la fois très moderne et elle a quelque chose qui traverse le temps que je trouve assez merveilleux. Et puis elle a un mystère très fort, ce qui correspond à la magie du cinéma.
Et George MacKay? Au départ, Gaspard Ulliel devait interpréter ce personnage, mais il est décédé...
Le film était écrit pour Léa et Gaspard. Gaspard est mort quelques semaines avant le tournage. On a décidé de ne pas le remplacer par un acteur français pour ne pas qu'il y ait de comparaison possible. J'ai eu le coup de foudre pour George en casting, après trois minutes d'essai. George a rendu le film à nouveau possible.
Comment travaillez-vous avec les interprètes?
Cela dépend avec qui je suis. Si on prend La bête, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas plus opposés que George MacKay et Léa Seydoux. George est quelqu'un qui a besoin d'être énormément préparé. On a beaucoup échangé par courriel et il avait un boulot énorme pour apprendre le français. Quand il arrive sur le plateau, tout est fait, on s'est déjà tout dit. Léa, au contraire, est quelqu'un qui n'aime pas se préparer. Elle a besoin de découvrir la scène quasiment en la faisant. C'est sa manière à elle de faire surgir quelque chose.
On peut entendre Xavier Dolan dans votre film...
J'ai vécu longtemps à Montréal. Je connais beaucoup de gens du cinéma québécois. Ma chef opératrice est québécoise. Nancy Grant, la productrice de Xavier, avait très envie de participer au film. On a monté une coproduction avec le Québec. Xavier est cette espèce de voix du futur.
Dans une oeuvre comme celle-ci, qui est très riche et complexe, comment élabore-t-on sa mise en scène? C'est un film sur une femme qui refoule ses émotions pour mieux s'y abandonner. Vous avez construit le long métrage avec une forme qui répond au fond. Une création qui peut être froide, distanciée et intellectuelle et qui, tout à coup, finit par s'humaniser.
Je fais beaucoup de préparation. En plus d'un cahier « scénario », j'ai un cahier « mise en scène ». Je note chaque fois quels sont les enjeux de la scène, ce qui peut être intéressant à explorer, etc. Quand j'arrive sur le plateau, j'ai 60 pages de notes et j'échange avec mon assistante, mon chef opérateur.
Ce sont dans les scènes de boîtes de nuit que les personnages semblent finalement prendre vie...
J'adore les scènes de boîtes au cinéma à partir du moment où elles racontent quelque chose. Filmer un personnage qui danse en dit long sur lui. C'est plus impudique de filmer quelqu'un qui danse que quelqu'un qui est nu dans une scène de lit. En revanche, les scènes de boîtes de nuit sont très difficiles à réaliser. La clé, c'est la figuration. Il y a tellement de scènes ratées, car on ne pense qu'aux acteurs principaux, et derrière les gens font semblant de danser.
La bête prend l'affiche le 19 avril.