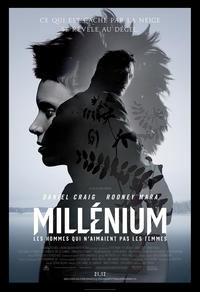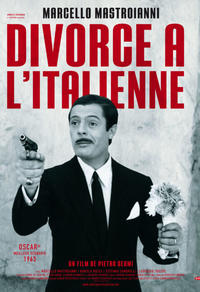Les idées au cinéma viennent parfois en paires, surtout lorsqu'il est question de concocter des films biographiques, que ce soit sur Truman Capote, Coco Chanel ou Yves Saint Laurent. Florence Foster Jenkins a passionné les gens dans la première moitié du 20e siècle. Riche femme influente, elle s'est adonnée à l'opéra malgré un manque total de talent. Un destin qui a inspiré deux longs métrages qui ont vu le jour pratiquement en même temps. Il y a d'abord eu Marguerite de Xavier Giannoli (À l'origine, Quand j'étais chanteur) qui a remporté quatre Césars - dont un pour la performance de Catherine Frot - et qui ne sera probablement jamais montré au Québec à cause de problèmes de distribution. Puis il y a Florence Foster Jenkins qui a eu un traitement royal à cause de ses stars.
C'est justement ce qui brille le plus au sein de cette production qui ne manque pas de glamour. Meryl Streep dans le rôle-titre, c'est l'évidence même. Bien que ses récents choix de rôles pouvaient laisser à désirer, l'actrice est splendide lorsqu'elle n'en met pas trop et sa retenue s'avère plus qu'appréciable. Son personnage n'aurait pu qu'être une fatigante caricature ambulante. Ce n'est heureusement pas le cas. Elle a une façon unique d'alterner entre des sentiments qui se trouvent aux antipodes et ce don opère à nouveau. Plus que dans Mamma Mia! et Ricki and the Flash où elle devait également chanter. Son mari et agent est interprété par Hugh Grant, l'ancien roi déchu de la comédie romantique qui tente de secouer sa carrière. Après le méchant génial qu'il campait dans le mal-aimé The Man from U.N.C.L.E., il la joue sobre, ce qui lui va comme un gant. Plus éclaté est Simon Helberg, un des héros de la série The Big Bang Theory qui leur vole régulièrement la vedette en pianiste tiraillé entre son désir de prendre ses jambes à son cou ou demeurer auprès de Florence, d'abord pour l'argent et puis par amitié.
Tout le film est d'ailleurs construit en dualité. Il y a cet humour - parfois niais, souvent savoureux - qui laisse croire à une satire même si l'honnêteté des sentiments est indiscutable. Puis il y a ces éléments dramatiques et plus émouvants liés à la guerre et aux maladies qui tirent vers la mièvrerie. La scène prend beaucoup d'espace, mais ce n'est pas au détriment de la sphère privée du couple. Il y a une ode naïve aux rêves et ensuite une attaque sournoise envers la critique et le bon goût dans un dernier tiers qui traîne en longueur. Le scénario de Nicholas Martin (un habitué de la télévision) veut tellement bien faire qu'il n'osera pas grand-chose, se contentant de passer rapidement sur des thèmes importants au lieu de s'y attarder. Impossible de ne pas reconnaître par son traitement classique une tentative de refaire une sorte de King's Speech qui, faut-il rappeler le rappeler, était reparti avec l'Oscar du meilleur film. Autant le sujet excentrique sort de l'ordinaire, autant le rendu aurait difficilement pu être plus conventionnel.
La démarche du cinéaste Stephen Frears épouse cette vision consensuelle, soulevant au sein d'une mise en scène lustrée l'élégance de l'époque (les années 40) sans prendre le moindre risque formel. Il a embauché Danny Cohen (le directeur photo attitré de Tom Hooper) pour séduire la rétine et son compositeur fétiche Alexandre Desplat pour faire la même chose avec l'ouïe. Rien ne dépasse du cadre et si son travail est plus inspiré que sur son récent The Program où il était question de Lance Armstrong, on est loin de The Queen et Philomena. Ou encore des grands opus qu'il a pu réaliser au début de sa carrière avec The Hit et My Beautiful Laundrette.
Florence Foster Jenkins ne renie en rien son côté rassembleur. Le résultat est gentil, tendre, divertissant et charmant tout plein. Des qualités appréciables pour passer un bon moment, à défaut de quelque chose de plus marquant et de plus ambitieux. Près de deux heures de cinéma sans trop s'ennuyer, c'est déjà pas si mal.